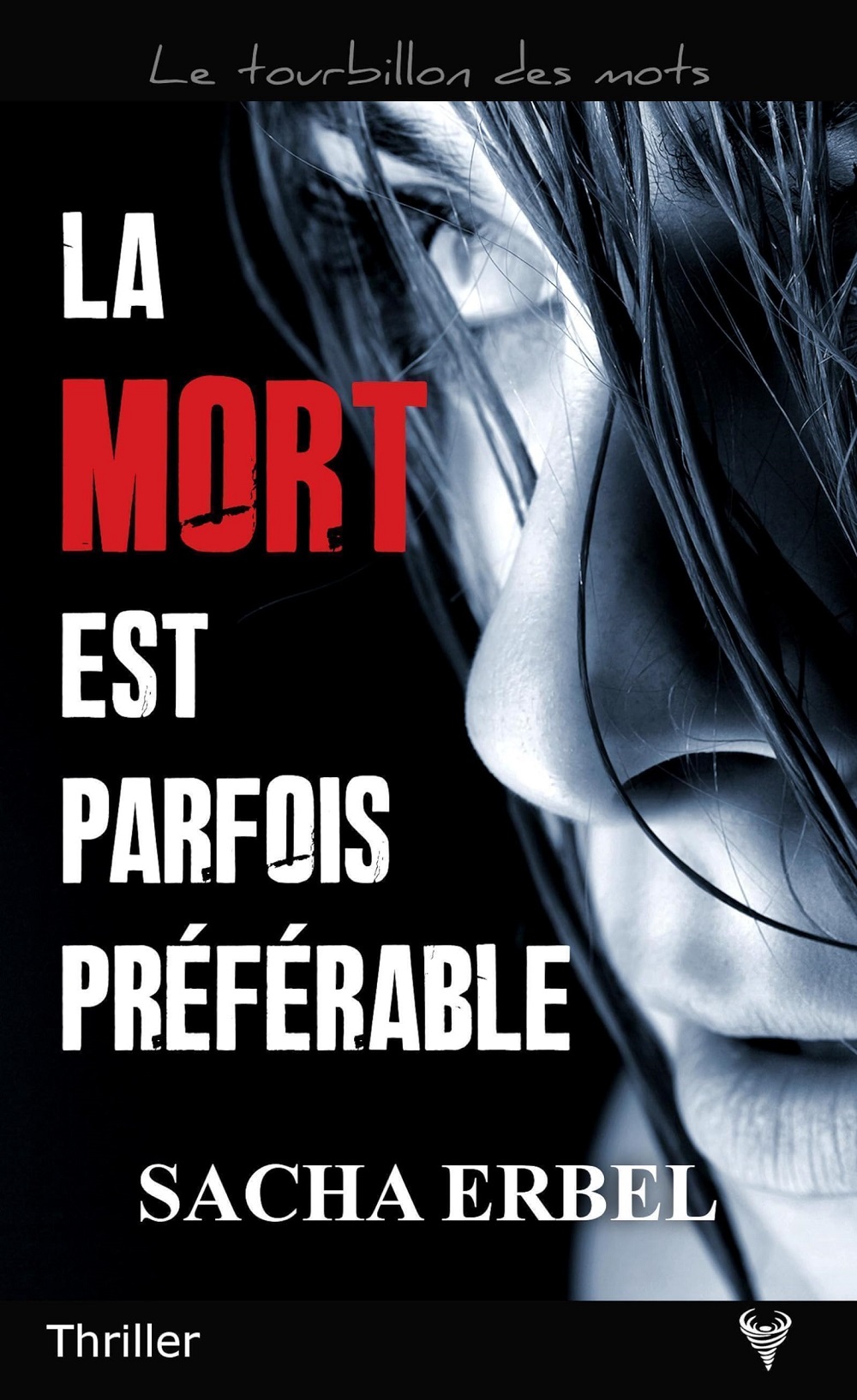« Blackout songs » explore les profondeurs de la dépendance affective

Très friand des textes anglo-saxons, dont il apprécie souvent la singularité de la construction ainsi que l’humour et la folie qu’ils contiennent, Arnaud Anckaert, l’un des directeurs de la compagnie théâtrale nordiste « Le Prisme », s’est fait une spécialité de mettre en scène ceux qui le touchent plus particulièrement. Ça avait été le cas avec « Orphelins » de Dennis Kelly mais aussi avec « Séisme » de Duncan Macmillan.
Au cœur d’une rentrée 2025 chargée, avec également la mise en scène de la pièce « Le Songe d’une nuit d’été », l’homme s’est attaqué à une œuvre récente (2022) de Joe White, « Blackout Songs », qu’il a fait traduire et dont il signe la première création en France. « J’ai été séduit par cette écriture que je connais et par le sujet, confie-t-il. Ça faisait longtemps que je voulais monter un texte autour de la dépendance et de l’amour, cette histoire d’un couple lié par la relation à l’alcool mais aussi à l’art. »
Une pièce tragicomique qui n’a rien d’une campagne de prévention contre les dangers de l’alcool : « L’alcoolisme n’est ici que le symptôme d’un mal bien plus profond. Nous vivons dans un monde addictif, que ce soit à la boisson, à la drogue, aux nourritures, aux écrans, rappelle-t-il. Ce qui m’intéressait ici, ce sont ces relations humaines parfois vertigineuses, que certains qualifient d’excitantes ou d’intenses mais que d’autres définissent comme toxiques. On parle davantage de dépendance affective. »
Pour incarner ce couple qui se remémore son histoire avec une vision et une version différentes après chaque épisode trop alcoolisé, Arnaud Anckaert et sa complice et codirectrice de la structure, Capucine Lange, ont fait confiance à Fabrice Gaillard, l’un des acteurs avec lesquels une fidélité s’est installée au fil des années et des créations. Pour le rôle féminin, c’est en revanche une première collaboration avec Caroline Mounier, pensionnaire de la première promotion de l’École du Nord à Lille. « Elle a une voix et un tempérament qui, à mon sens, allaient coller avec le personnage, indique le metteur en scène. De fait, à la lecture, ça a bien fonctionné. Ils forment un duo touchant, attachant, avec des situations qui sont drôles même si elles sont souvent tragiques. »
« Blackout songs », mise en scène d’Arnaud Anckaert. Avec Caroline Mourier et Fabrice Gaillard, au salon de théâtre de la Virgule à Tourcoing, boulevard Gambetta. Du jeudi 11 au samedi 20 décembre, sauf les dimanche et lundi. Représentations à 20 h en semaine, à 17 h le samedi. Prix : 10 à 20 €.