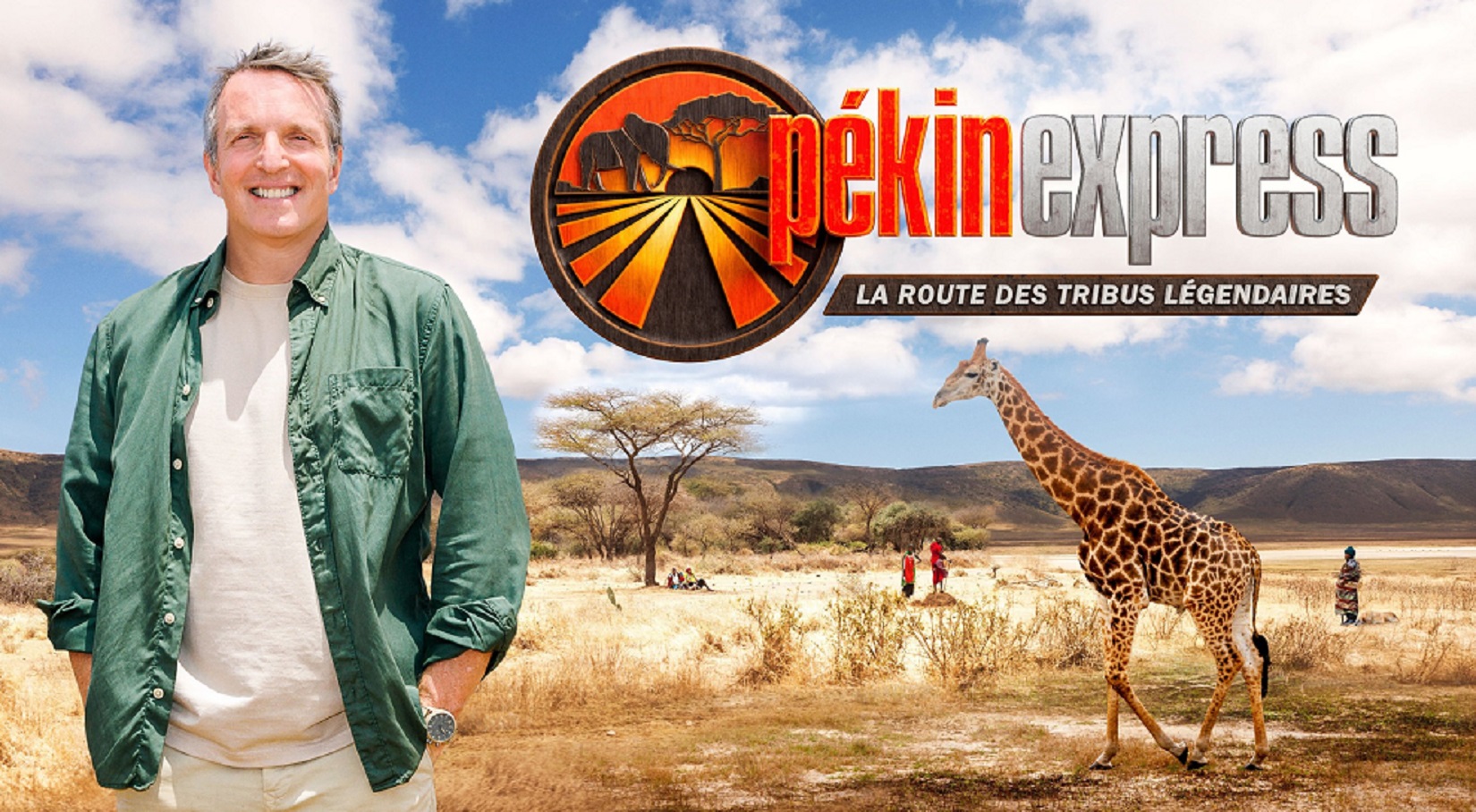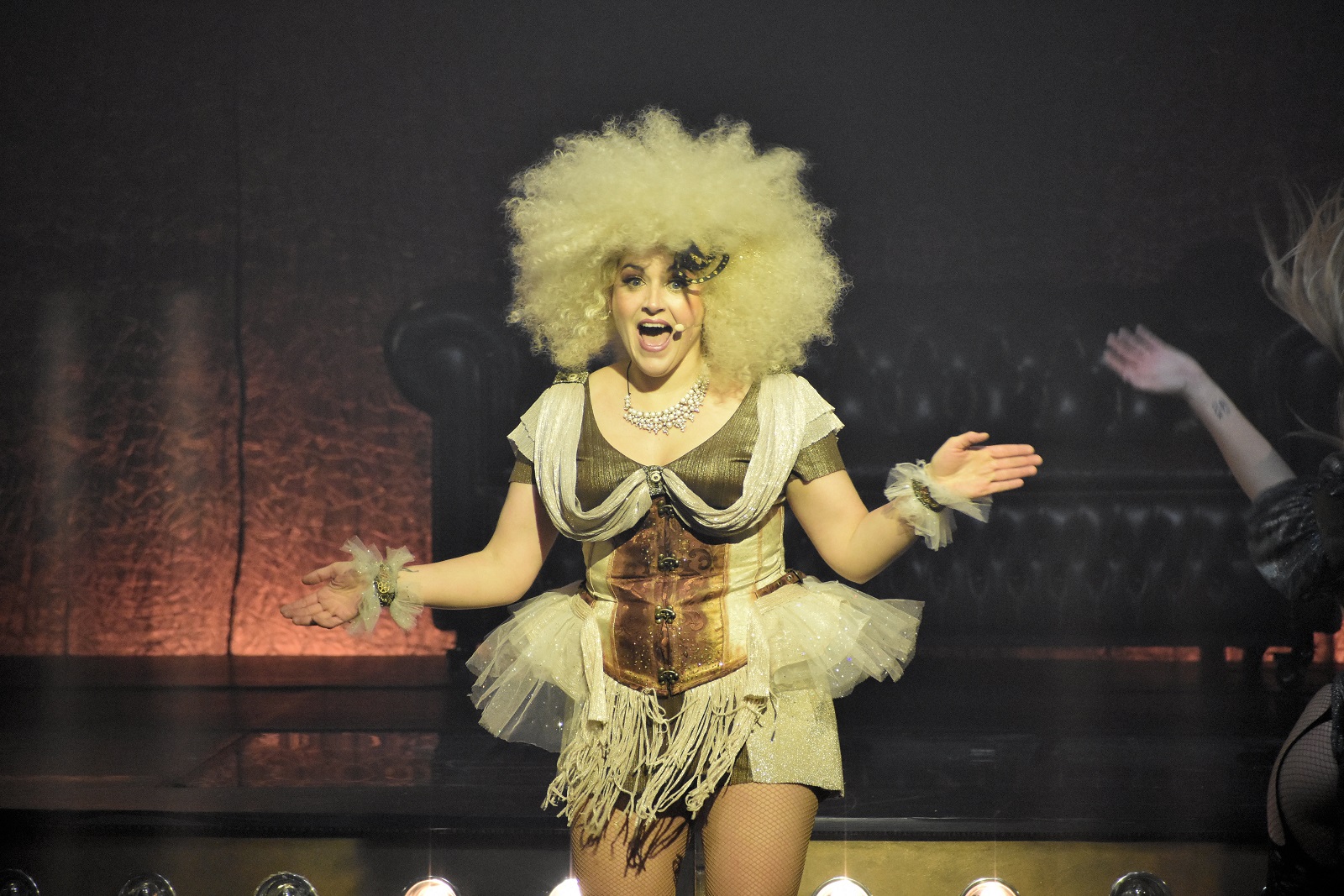Alban Parmentier trace son chemin sans griller les étapes

Petit à petit, l’oiseau fait son nid. Encore étranger des scènes d’humour de la région, il y a cinq ans, Alban Parmentier se fraye tout doucement un chemin dans le petit monde des comédy clubs. Ce lundi 20 janvier, avec son camarade Adrien Bonan, ils se partageront même l’affiche pendant une heure au Spotlight de Lille. Une étape supplémentaire avant de se lancer seul dans le grand bain avec un spectacle complet. « Je pense avoir aujourd’hui plus d’une heure de texte mais il faut une cohérence, une mise en scène. Je ne peux passer de 15-20 minutes à 1 heure du jour au lendemain, c’est bien d’y aller progressivement de ne pas brûler les étapes. »
Fan dans sa jeunesse de Dany Boon et Courtemanche, Alban Parmentier s’est, en vieillissant, davantage tourné vers l’absurde : « J’aime bien les gens qui savent aller loin dans leurs délires, des gars comme Mathieu Fraise, Alexandre le Rossignol ou Julien Santini. J’aime quand je suis surpris. »
Le déclic pour monter sur scène s’est opéré grâce à Thomas Deseur qui est désormais un humoriste confirmé : « En fait, je suis arrivé sur le tard en faisant du théâtre d’improvisation à 30 ans, explique-t-il. J’ai croisé la route de Thomas qui m’a encouragé à essayer la scène. J’ai testé, pour le plaisir, mais pendant trois ans, j’ai dû jouer seulement une dizaine de fois. Je m’y suis réellement mis il y a deux ans en suivant un atelier hebdomadaire avec un autre humoriste, ça m’a permis de faire un gros bond en avant. »
Depuis, des portes ne cessent de s’ouvrir. Alban Parmentier devrait même se produire début février en ouverture du gala Lillarious. En parallèle de ses spectacles, ce grand sportif, ancien athlète sur piste devenu trailer (il a fait un trail de 100 km à La Réunion au mois d’octobre) à Villeneuve-d’Ascq, travaille à mi-temps comme kinésithérapeute. « Mes clients sont à la fois une source d’inspiration et il m’arrive de tester mes vannes avec eux, confie-t-il. J’en balance aussi quelques-unes discrètement lors des discussions avec des copains et je vois si ça prend. Ma compagne, Céline VDB est aussi humoriste donc il nous arrive de répéter ensemble, d’échanger des idées. »
Alban Parmentier et Adrien Bona, 30 minutes chacun, ce lundi 20 janvier (21 h) au Spotlight à Lille. Clémence Baron se chargera de la première partie.